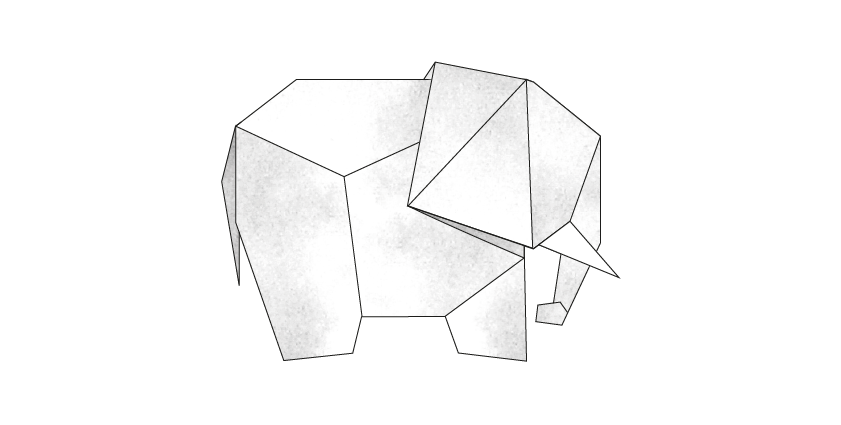2010
Film réalisé dans le cadre d’une thèse en socio-anthropologie visuelle intitulé Expérience du temps et de l’espace. Regards croisés sur la Basilicate.
Réalisé seul sur le terrain, avec très peu de moyen, ce film constitue ma seconde expérience filmique. Il occupe une place particulière par la force des relations établies avec les personnes présentes dans le film.
2007, Berna, Leo et Francesco habitent la Basilicate où ils militent pour la production et la consommation éthique. Ils réagencent une lecture de leur territoire à partir de Matera, du sud de l’Italie, ou plutôt des sud du monde confrontés à l’organisation mondiale contemporaine.
Le film ouvre une réflexion sur la réappropriation du temps individuel et collectif, du temps dans l’organisation capitaliste et de l’agir collectif prenant l’exemple d’une génération de « trentenaire » qui cherchent des solutions acceptables pour leurs propres vies dans une région qui est historiquement, une terre d’immigration et de pauvreté économique. Cette région, la Basilicate est au cœur d’une problématique sur le développement du sud de l’Italie et la question méridionale qui peut être identifiée comme concomitante à l’unification de l’Italie en 1861.
Ce groupe développe des propositions de modes de vie à la fois ancrée dans le local (production biologique, artisanat, associations, entre aide…) et connectée au global en prenant part à des initiatives avec d’autres réseaux et organisations nationales et internationales. (AMAP, commerce équitable, journée de sensibilisation, actions politiques de résistances et d’informations, accueil de woofers et d’associations de passage à Matera…).
Notes de l’auteur
De la campagne à la ville, de l’agriculture à l’artisanat, de l’association de commerce équitable à celle d’acquisitions solidaires (AMAP) ou du laboratoire de théâtre, de l’individuel au collectif, le film mélange approche des genres, des rythmes et des tons. Ces approches au nombre de trois répondent à des exigences et des parties pris cinématographiques en résonance avec les trois portraits mis en avant dans le film.
L’approche par observation est liée au rythme quotidien, au rythme répétitif de la nature et des gestes du travail de l’agriculteur calqué sur les rythmes de la nature et de son travail dans différents lieux et moments de vie. Les images du travail paysan rentrent en écho avec le récit s’inscrivant dans le temps long, abordant les transformations de cette région depuis 70 ans. Ici évoquer le passé comme moyen de connaissance du présent c’est
parler des modalités de son appropriation par un individu. C’est aussi le temps de réflexion sur le travail en train de s’accomplir, d’autoanalyse et des projections futurs. L’approche dialogique est liée à celle des rencontres des idées, des valeurs et des personnes, de l’altérité et de l’échange, la tentative de créer des ponts, de faire collectif dans la confrontation et le débat d’idée, moteur de l’action. L’approche fictionnelle porte sur la magnification du travail de l’homme, de son lien local, de la beauté du savoir-faire, d’une temporalité particulière, mais aussi de la poésie qui
peut se dégager du regard d’un homme sur son travail, ses rencontres, sa ville, ses amis…
Ainsi, le film partage l’histoire d’un groupe composé d’individualités mise en perspective par les procédés cinématographiques concourant à l’apparition d’un agir collectif régit par des valeurs de solidarités et d’un ensemble de manières de penser dans l’objectif de redonner sens et avenir à un monde qui semble en être en partie dépourvu.
La génération que j’ai étudié, née majoritairement dans les années 1970, illustre bien cette problématique entre rupture et continuité. Berna, Leo et Francesco se positionnent individuellement et sous forme associative, à la fois dans un commerce équitable global et dans le soutien et la valorisation des petits producteurs agricoles locaux, les moins biens armés face aux logiques de la mondialisation. Ils forment un groupe ou l’interconnaissance
est forte, peut être même, qu’ils forment un microcosme, mais ils revendiquent tout autant une ouverture et une intervention sur le territoire pour promouvoir de nouvelles pratiques sociales autour de la production et de la consommation critique. Ils engagent dans leurs actions et leurs systèmes de valeurs une redéfinition des conventions, des pratiques de productions et plus généralement, des manières d’habiter. Ils sont sensibles notamment aux notions d’autonomie, de souveraineté alimentaire et d’individualisme solidaire. Les pratiques et les dynamiques locales sont parfois conflictuelles, d’autres fois agrégatives. Elles soulèvent des enjeux entre les individus eux-même, l’existence de chacun dans un groupe; et visent, un objectif d’autonomie accrue pour exister dignement. Elles sont des réponses au système d‘organisation de la société et à une « cosmogonie » historique du territoire, qui leur sont toutes les deux défavorables.
Historiquement, la stratification des représentations place la Basilicate sous le jouc d’un regard dominant, objet d’un sujet tributaire d’une vision évolutionniste caractérisé par la conception linéaire du temps et du développement.
La Basilicate a été perçu et est apparu dans l’Histoire comme Terre archaïque, immobile, arriérée, isolée, d’une civilisation paysanne, magique et miséreuse, de l’absence du Christ, Terre d’une longue émigration et terre de « la honte nationale » à la sortie de la seconde guerre mondiale avec les Sassi de Matera, elle deviendra dans les années 80 patrimoine mondial de l’UNESCO, entre temps, elle a été la Terre des chercheurs, de l‘anthropologie italienne, la Terre de l’échec de l’industrialisation, des « cathédrales du désert », des occasions perdues, ou encore la terre du cinéma aux thèmes bibliques, ou dernièrement une terre gastronomique au cœur et aux valeurs antiques. Beaucoup de choses en vérité, et parfois contradictoire.