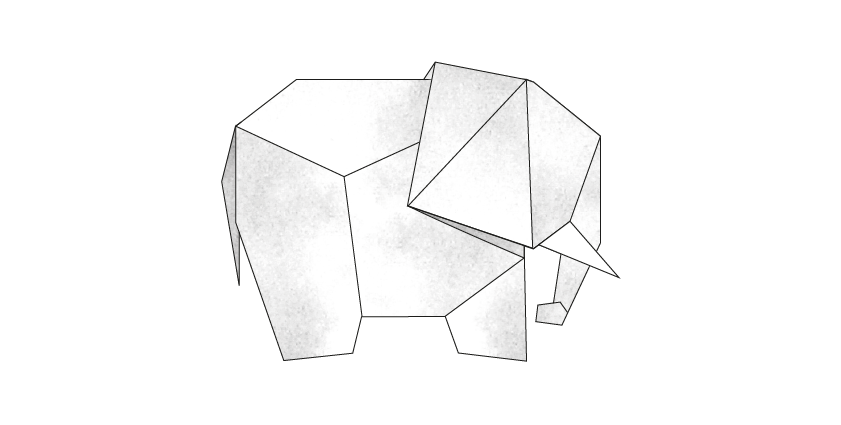2021 – De Clovis Gorisse
Film de stage d’étude pratique dans le cadre d’un Master à l’Ecole Nationale Supérieures d’Architecture de Paris La Villette.
Résumé:
Trois histoires autour de la préservation d’espaces dits naturels et de la cohabitation entre l’homme et le reste du vivant, au coeur de la forêt de Fontainebleau.
Le terme de sanctuaire sera une constante et sa polysémie sera moteur de l’enquête : un sanctuaire en effet peut, dans le cadre de la protection de l’environnement, désigner un morceau de territoire « mis sous cloche » dans lequel l’homme n’intervient pas ou peu afin que le reste du vivant puisse demeurer en libre évolution. Mais le terme peut aussi qualifier un lieu privilégié, parfois sacralisé, et dédié à la pratique d’un culte. Un lieu qui est donc bien habité par l’homme, mais habité de façon très spécifique.
Ainsi, plusieurs manières d’habiter seront mises en tension. Mais aussi, parce que l’un ne va pas sans l’autre, plusieurs manières de voir, de concevoir et de représenter le paysage que l’on habite. Ces questionnements, au regard des crises écologiques que nous traversons actuellement, rejoignent les débats contemporains vis à vis de l’impact de l’homme sur la planète.
Intentions:
Cette enquête mise en récit aura pour objectif d’éclairer certains des enjeux politiques et sociaux de ces débats, mais aussi de décentrer les regards afin de nourrir un nouvel imaginaire d’action. Ces récits, tout en émergeant d’images de terrain, se présenteront sous forme de mises en scène à la lisière de la fiction afin d’incarner le plus justement possible les histoires dont il sera question. Construits selon trois genres cinématographiques différents – une promenade rejouée, une conversation illustrée et une rêverie mise en images – les récits, montés les uns à la suite des autres, entreront en échos afin de constituer un propos global tout en faisant entendre plusieurs voix.
Les liens tissés entre des hommes et un paysage sont aussi bien politiques que poétiques, et la forme filmique, tout en permettant une problématisation des manière d’habiter, est aussi un outil qui permet de rendre sensible ces liens poétiques.
1. Portrait de Dorian Gray, tableau d’une forêt
Le premier récit s’attachera à l’histoire des peintres de l’École de Barbizon qui, au milieu du XIXème siècle, ont milité pour la création des tout premiers sanctuaires de la nature sur le territoire français, afin de préserver des actions humaines certains fragments de la forêt de Fontainebleau. Des morceaux de territoire qu’ils appréciaient tout particulièrement pour leur caractère esthétique et paysager. Ce premier récit documentera donc la genèse des sanctuaires de la nature et les intentions initiales qui sous-tendaient ces espaces. Il permettra de montrer qu’un paysage n’est pas une « vue » ou du moins qu’il n’est pas que cela. Enfin il introduira les tensions développées par la suite entre la libre évolution du vivant et la présence humaine au sein des milieux.
2. Les sanctuaires de papier
Le deuxième récit se présente sous la forme d’une réflexion à propos de l’éventualité d’un Parc National à Fontainebleau, et au sujet des Parcs Nationaux à la française en général. L’approche n’est pas unanimement défendu par tout ceux qui déjà oeuvrent pour sa défense sur le terrain. Et pourquoi toute cette affaire traine depuis si longtemps? Il permettra également de présenter une conception dans laquelle les individus font parti intégrante du paysage. Celui-ci étant alors vu comme un processus vivant, qui fait les hommes et qui est fait par eux. Cette vision du paysage, qui était celle entre autre de Gilbert André, apparaitra comme étant peu compatible avec un aménagement du territoire pensé par le haut et de manière dématérialisée, ce qui invite à imaginer en parallèle d’autres modalités de négociation entre les hommes et les milieux qu’ils investissent.
3. Même les rochers vieillissent
Le troisième récit articulera plusieurs pratiques et une démarche architecturale directement liés aux rochers de grès qui caractérisent le paysage de Fontainebleau. Chacun des exemples fournit une occasion de penser le paysage dans son épaisseur temporelle, et de l’appréhender comme une entité dont les formes sont générées par le mouvement, comme un ensemble qui sans cesse se fait et se défait… Chaque objet s’accompagne également d’images. Mais ce sont ici des images qui précèdent la réalisation de l’objet, qui l’anticipent et qui sont le lieu de son imagination.
Il sera d’abord question de la pratique de l’escalade telle qu’elle est exercée sur les blocs de Fontainebleau. Les promesses contenues dans les topo-guides et la pratique elle-même sur le terrain génèrent des désirs, des récits et des attachements. Tout cela plaçant les grimpeurs en position d’être affecté par le paysage, par le biais d’une expérience à vivre de manière sensible, en contact direct et physique avec le lieu.
La seconde pratique, beaucoup plus ancienne, témoigne elle aussi d’un attachement physique et tactil au paysage. Lors du Mésolithique les individus qui habitaient la forêt avaient développé un rituel qui consistait à graver à l’intérieur de cavités exiguës creusées dans certains rochers des motifs abstraits et répétitifs. Ainsi, par cette pratique rituelle le paysage acquière sa consécration. Passant du domaine profane au domaine sacré il devient un sanctuaire. Un sanctuaire vécu, habité et éprouvé sur le plan de la sensibilité. Ces images feront écho à la pensée développée par Tim Ingold dans son étude des rapports croisés entre les hommes et les milieux qu’ils habitent : l’anthropologue défend la thèse selon laquelle les individus, où qu’ils aillent et quoi qu’ils fassent, font des lignes, des lignes qui s’incorporent dans les paysages. Une création musicale composée à partir de ces visuels originaux, accompagnera la rêverie. Cette composition deviendra le véhicule d’une charge émotionnelle difficilement communicable mais pourtant indissociable des exemples sélectionnés.
La démarche architecturale est celle qui a guidé le dessin de l’architecte Roland Simounet lors de la conception du Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France en périphérie du massif forestier de Fontainebleau. Cette démarche a justement été inspirée par ces roches travaillées par le temps et les hommes. Bâtiment-paysage, l’édifice modifia le site avant que le site lui-même ne modifie le bâtiment par la suite. Ainsi l’image imaginée par l’architecte ne s’oppose pas à la marche du temps et aux métamorphoses à venir. N’étant pas figée, elle peut faire du vivant son co-auteur.